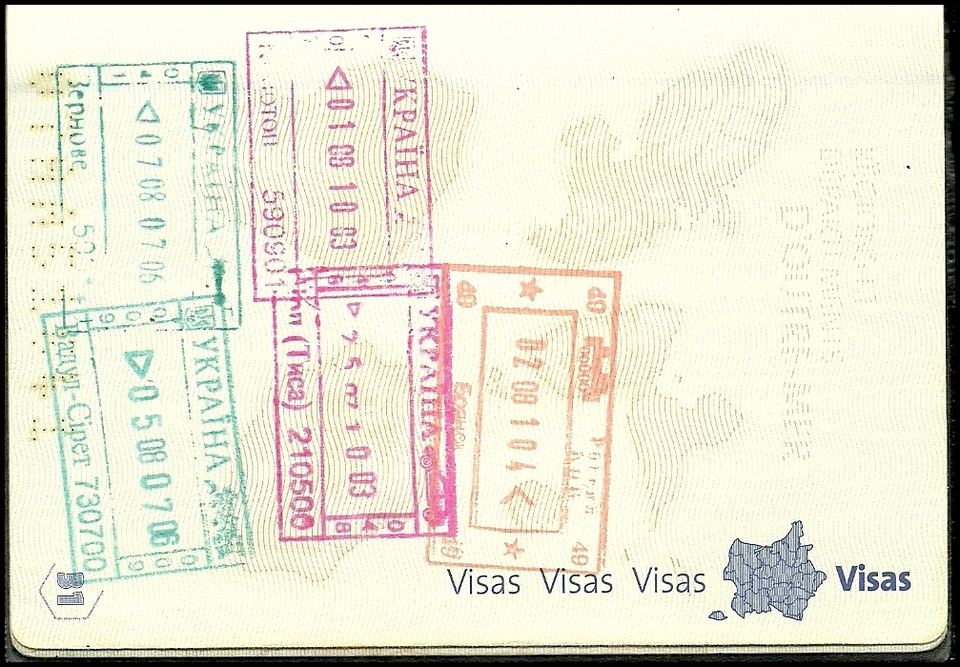
Entre la Serbie et la Hongrie
Après un séjour de trois semaines auprès des harragas de Grèce, il nous tardait d’aller fouiner le long de la frontière orientale de l’Europe. On voulait savoir à quoi pouvait bien ressembler l’enceinte de la citadelle et ses dispositifs de surveillance. L’idée était de voir les agents de Frontex en action.
On se pose d’abord à Subotica, en Serbie, à quelques kilomètres du poste-frontière de Horgoš vers la Hongrie. De là, on s’organise une escapade vers la frontière, en évitant les grosses routes. Nous voulons éviter les postes de contrôle et nous confronter à ce qu’on croit être une frontière grillagée et surveillée par des tours de contrôle. Après une brêve entrevue dans un champ de navets avec des paysans ukrainien, nous suivons une petite voie ferrée qui relie la Serbie au petit village hongrois de Röszcke. Le long de la voie, de vieux miradors abandonnés dominent les champs. A force de marcher sans voir un seul garde-frontière, nous commençons à nous demander si nous sommes toujours en Serbie. Nous sommes persuadés qu’à un moment donné nous tomberons nez à nez avec un grillage ou des barbelés.
C’est seulement après avoir traversé une route et alors que nous approchons d’un village visiblement hongrois que nous sommes rejoins par une jeep de la police hongroise (Rendörseg). Deux gardes (un homme et une femme) en sortent en courant dans notre direction, visiblement alertés par notre présence. On s’explique, on leur dit que nous nous sommes trompés, que nous ne savions pas. Il vaut toujours mieux jouer aux cons. L’homme est méfiant, mais la femme est sympa. Elle regarde nos passeports européens et ne sait pas comment réagir : c’est pas tous les jours que des européens entrent illégalement en Europe. Elle finit par appeler le poste-frontière.
Très vite, une seconde jeep s’approche. En sort un agent de la police serbe et… un agent de la PAF française, avec un brassard Frontex au bras. Nous n’avions pas espéré mieux ! Il nous aborde avec un sourire faux et nous demande comment on est arrivés là, nous confirme que nous avons violé la frontière. Nous comprenons alors que la frontière en question n’est matérialisée que par quatre pierres blanches disposées de part et d’autre de la voie ferrée. Ils mène alors son enquête sur nous en posant une série de questions sur notre ville d’origine. Qui est le maire ? Où se trouve le café Machin ? Puis il prend une photo de nous, ce que nous pouvons difficilement refuser si nous voulons continuer à passer pour de banals touristes.
Finalement, nous sommes emmenés au poste frontière pour signer des documents. Dans le poste, à côté des toilettes, nous entrevoyons un local de rétention avec une personne derrière les barreaux. Mais nous sommes bientôt pris en charge par la police hongroise qui nous fait payer 10 000 forints d’amende pour avoir « quitté illégalement la Serbie ». Le comble !
Le soir, alors que nous quittons la Hongrie et après avoir galéré pour trouver une poste où payer notre amende, nous repassons par le poste-frontière et tentons de faire du stop pour rejoindre Subotica. Les gardes serbes nous chassent plus loin sur l’autoroute. Sur un pont, deux jeeps serbes surmontées d’un radar et pourvues d’écrans de contrôle scannent la campagne. Notre passage, au milieu de la nuit, nous amène à être à nouveau contrôlé, mais sans soucis cette fois…
Les jours suivants, installés à Szeged dans le sud de la Hongrie, nous louons des vélos pour suivre plus de 30 kilomètres de frontière, afin de vérifier si effectivement aucune barrière ne matérialise la frontière de l’Europe. Entre Röscke et Tompa, plus à l’Ouest, nous ne trouvons que des pierres blanches espacées les unes des autres de 30 à 50 mètres.
La frontière n’est donc pas visible ! Nous n’avons vu aucun migrant non plus.
Transcarpathie
On quitte la Hongrie pour l’Ukraine. L’un de nous part vers la Pologne pour « visiter » le siège de Frontex à Varsovie. Nous ne sommes plus que deux.
Entre Zahoni et Chop, un pont de métal est posé sur le fleuve. De part et d’autre, les barrières de douanes séparent l’Ukraine de la Hongrie. Le passage à pieds est interdit, les contrôles sont sévères. Une file ininterrompue de minivans s’étend du côté hongrois : des dizaines de travailleurs saisonniers ukrainiens reviennent d’Italie, rapportant avec eux des amoncèlements de cadeaux pour leurs familles. Les gardes-frontières hongrois vérifient ce qui sort, les ukrainiens ce qui entre. Mais le manège des minivans remplis d’ukrainiens n’est pas leur priorité, ils attendront bien un peu. Pour passer la douane, il faut réussir à grimper dans une voiture, mais la présence d’un « invité » sur la banquette arrière peut coûter un petit backshish au conducteur, il faut le savoir. Après une bonne heure, on finit par passer.
Arrivés en Ukraine sous la pluie, nous nous installons à Uzhgorod, deuxième ville de Transcarpathie. Ici aussi, les flux migratoires sont invisible. Il y fait bon vivre, malgré un chômage qui explose et un temps mi figue mi raisin : les nuages s’accrochent sur les sommets alentours et arrosent tranquillement les rues animées du centre. A première vue, on ne voit pas beaucoup d’étrangers.
Nous mettons du temps à entrer en contact avec des migrants. Après quelques recherches, on trouve le petit bureau du Comité d’Aide Medicale de Transcarpathie (CAMZ), au 27 rue Gagarina, animé notamment par Natacha et Oksana, deux jeunes femmes très chaleureuses qui nous expliquent la situation dans la région. Le comité s’est créé pour venir en aide à des enfants handicapés, mais accueille régulièrement des migrants pour les aider dans leurs démarches d’accès aux droits. Le comité participe aussi à une veille critique des frontières de l’Europe sur Internet, le projet Bordermonitoring Ukraine. Il intervient aussi dans des séminaires universitaires et organise parfois des événements en faveur des migrants, mais sa marge de manœuvre est limitée par ses faibles moyens. Il faut dire qu’elle n’a pas l’intention de se plier au double jeu que jouent d’autres associations dans la région pour obtenir des financements. On en reparlera plus bas.
Quelques coups de fils plus tard, nous rencontrons Tapan, un jeune srilankais, qui vit à Uzhgorod avec un papier provisoire et travaille comme traducteur auprès des autorités. Nous découvrons la petite pièce qu’il partage avec d’autres srilankais, puis nous l’accompagnons au Service régional des migrations, au 2 rue Zagorsna. Tous les migrants déclarés doivent s’y présenter tous les deux mois pour renouveler leur papier provisoire (DOVIDKA). D’abord un papier rouge, le temps de la demande d’asile et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, puis un papier vert, qui atteste du dépôt d’un recours après un décision négative. Dans les faits, l’attribution d’un papier vert après le rouge est quasi systématique, dans la mesure où l’Ukraine n’accorde pas l’asile et n’expulse pas non plus. Les migrants peuvent ainsi stagner des années à Uzhgorod avec un papier vert…
Parmi les migrants qui sont bloqués ainsi en Transcarpathie, nous rencontrons Kahin, Hussein et leur compagnons somaliens, qui vivent à près d’une quinzaine dans un appartement de deux pièces avec cuisine. A huit par chambre, ils payent chacun à peu près 1100 grivni par mois. Ils nous expliquent qu’à leur connaissance il y a environ une dizaine d’appartements comme le leur dans la ville, répartis entre somaliens, afghans, srilankais et bangladeshis. Ils se débrouillent pour survivre, mais le quotidien est rude, parfois même violent : après des agressions racistes répétées, ils ne sortent plus après six heures du soir, de peur de croiser des néonazis. L’un d’entre eux est dans cette situation depuis plus de quatre ans. Un autre nous avoue qu’il pense parfois retourner en Somalie où les milices islamistes l’ont menacé de mort parce qu’il travaillait au guichet d’un cinéma : « Au moins en Somalie, j’avais ma destinée entre les mains, je pouvais décider de ce que je fais. Ici je perds ma vie, je ne peux rien faire, je suis coincé ». Mais même pour rentrer il n’a plus d’argent.
L’Ukraine ne donne pas l’asile. De façon générale, elle ne donne pas grand chose, voire rien du tout. Les migrants arrivent cachés dans un camion, puis tentent très vite de passer en Pologne ou en Slovaquie. Les passeurs les débarquent dans des caches en pleine forêt, puis leur montrent le chemin par la montagne pour passer la frontière. Mais après des heures de marche, ils finissent le plus souvent par être arrêtés par les gardes frontières. Un somalien accuse les gardes ukrainiens d’organiser eux-mêmes le trafic, s’appuyant sur des photos de soldats qu’on lui a présenté au moment de son arrestation par les gardes slovaques.
Ramenés régulièrement aux gardes ukrainiens, les migrants sont alors enfermés au camp (« Temporary detention center ») de Chop pour 6 mois (15 jours pour les ressortissants de la C.E.I.). Les mineurs sont transférés au « baby lager » ou au centre ouvert (« Accomodation center ») Latoritsa de Mukachevo. A Chop, les conditions d’accueil sont limite, les migrants doivent acheter leur eau à la bouteille (20 UAH = 2 euros). Quand ils sortent des camps et font une demande d’asile, ils obtiennent un récépissé (dovidka) rouge valable 2 mois, renouvelable le temps de la procédure. Après le refus de la demande d’asile, ils recoivent un récépissé vert valable 2 mois, renouvelable le temps du recours devant un tribunal. Ce dernier papier, que la plupart des migrants ont en poche, est généralement renouvelé indéfiniment, puisque la décision de justice n’est jamais rendue. Ils n’ont donc aucun statut leur permettant de travailler. Certains vont jusqu’à Odessa pour travailler de façon saisonnière sur les marchés, parce qu’en Transcarpathie le chômage atteint déjà des records parmi les ukrainiens, alors il est impossible de trouver quelque travail que ce soit.
Les migrants que nous rencontrons nous évoquent tous la souffrance psychologique qu’implique l’attente et l’absence d’issue. Ils n’ont plus d’argent pour retenter la traversée et ne trouvent aucun travail. Certains attendent depuis plus de deux ans, d’autres sont là depuis cinq ans. Le soir, ils ont peur de sortir de l’appartement, évoquent les agressions régulières de la part de skinheads. Un somalien nous confie que dans ces conditions, la guerre dans son pays d’origine lui paraît moins douloureuse que l’attente en Ukraine : il estime que dans cet état, sa vie n’a aucun sens.
Les jours suivants, nous essayons d’en savoir plus sur les centres de rétention pour migrants de la région, qui sont au nombre de cinq depuis que le bouge de Pavshino a été fermé. Les filles du CAMZ nous expliquent qu’il y a deux types de centres : les centres ouverts ou « accomodation centers » et les centres fermés ou « temporary detention centers ». Après quelques recherches, nous apprenons qu’il y a trois centres fermés à Chop, Mukatchevo et Lutsk et deux ouverts, à Perechin et Mukatchevo.
Nous décidons d’aller voir les centres de rétention de Mukachevo et d’y rencontrer l’association Neeka, financée par le Danish Refugee Council, un fond caritatif adventiste. Nous n’arrivons pas à entrer dans les centres, mais rencontrons les deux principaux responsables de l’association qui les « gère ». Ceux-ci se ventent d’avoir accumulé des partenariats avec le HCR, l’OIM et d’autres organisations collabo et de travailler main dans la main avec les autorités locales et la police et semblent voir en nous un partenariat possible avec des associations françaises. Leur discours cachent mal leur attitude prosélyte et néocolonialiste : ce n’est pas à demi mots que l’un d’eux nous avoue qu’ils seraient ravis de pouvoir bénéficier en Europe d’un réseau de partenaires assez solide pour obtenir des fonds européens permettant la mise sur pied d’un système de réadmission des migrants entre l’Europe et la Russie par le biais de l’Ukraine ! Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car après nous avoir montré l’église qu’ils ont fait construire dans le quartier tsigane et raconté comment un ancien résident du centre de Latoritsia est devenu un bon chrétien grâce à eux, nous apprenons que NEEKA gère également en collaboration avec les autorités le centre fermé pour mineurs de Mukatchevo, appelé aussi « Baby lager ». Et pour couronner le tout, de leurs propres mots nous apprenons qu’ils sont en lien quotidiennement avec la police aux frontières pour « aller chercher les migrants arrêtés aux points frontières et les amener aux centres ».1
Nous comprenons qu’ils se partagent avec Caritas la gestion des centres de rétention de Transcarpathie : Caritas intervient à Chop (centre fermé) et Lutsk (centre « ouvert » de 8:00 à 21:00), Neeka au « baby lager » (centre fermé) et à Latoritsa (centre « ouvert » de 8:00 à 21:00). Etant donné qu’ils en sont les gardiens, nous pensons qu’ils devraient pouvoir nous laisser entrer dans le centre « ouvert » de Latoritsa, rue Mitchourina, qui habituellement peut accueillir des visiteurs. Sur place, nous rencontrons Ahmed, un jeune afghan hébergé au centre. Il demande à nous faire rentrer comme il le fait d’habitude avec ses amis, mais le vieux gardien refuse, alors nous discutons au bord de la rivière. Il nous explique que c’est un centre pour familles et jeunes isolés. Les résidents du centres sont libres d’aller et venir la journée entre 8:00 et 21:00, mais doivent rester dans le centre la nuit. Occasionnellement, ils peuvent avoir l’autorisation de passer la nuit hors du centre.
La ville des tsiganes
Avant de quitter Mukachevo, je reste seul pour faire un tour dans un quartier qui avait attiré mon attention. Sur le plan de la ville, il est appelé « Tsiganskij Tabir » (campement tsigane). Cet endroit incroyable est en réalité une ville habitée par près de 5000 rroms originaires de Hongrie. Entièrement construit à la main et fait de briques de terres, parcouru par des chemins de boue et sans approvisionnement en eau, l’endroit apparaît comme une immense zone de relégation. Mais ses habitants, eux, sont chaleureux et vivants comme personne. Leur accueil est inoubliable !
Je n’y suis pas resté longtemps, mais je compte bien y retourner.
Les forêts des Carpates sont un passage difficile. Après des kilomètres de marche dans la montagne, le fleuve et la route sont un obstacle supplémentaire. La traversée de la frontière se solde presque toujours par un échec. Du côté européen, les polices tchèques et hongroises veillent et n’hésitent pas à remettre les captifs aux gardes ukrainiens, en totale violation du principe de non refoulement. La nuit, on le sait, personne n’est là pour prouver qu’ils sont bien arrivés de l’autre côté. Certains migrants accusent même les gardes ukrainiens de jouer les passeurs avant d’avertir leurs collègues de la présence des migrants qu’ils ont fait passer. A l’évidence, le business est à la fois rentable et sans risque.
Mais en dépit des entourloupes et des contrôles, la frontière reste poreuse. Dans la nuit, et malgré les spots qui éclairent les flots du Dniepr, les migrants continuent d’entrer dans la « citadelle Europe »…













